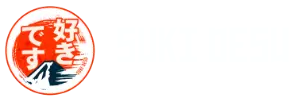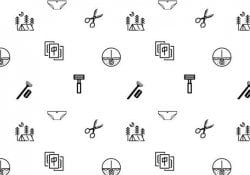Enjo-kōsai (援助交際) ou «relation assistée», en abrégé enkō, est l'acte de lycéennes (13-17) ou de femmes au foyer sortant avec des hommes plus âgés pour de l'argent, des cadeaux de luxe, entre autres.
Ce ne sont que des réunions pour dîner, karaoké, cinéma, marcher main dans la main et tenir compagnie. La pratique du sexe à Enjo-kōsai n'est pas courante, mais elle peut arriver dans une mesure limitée ou dans certains cas.
Índice de Conteúdo
Définition
La nature de l'Enjo-kōsai est fortement contestée au Japon. La connotation la plus courante est que l'enkō est une forme de prostitution enfantine dans laquelle les filles participantes vendent leur corps en échange de produits de marque ou d'argent.
L'anthropologue Laura Miller soutient dans ses recherches que la plupart des dates auxquelles Enjo-kōsai a eu lieu consistent en des groupes de filles qui accompagnent un groupe d'hommes plus âgés dans un bar karaoké pendant plusieurs heures et sont rémunérées pour le temps qu'elles ont passé avec vos compagnons. .
En outre, dans une enquête menée en 1998 par le Fonds pour les femmes asiatiques, les chercheurs ont constaté que moins de 10% de toutes les filles du secondaire étaient impliquées dans Enjo-kōsai et plus de 90% des filles interrogées ont déclaré qu'elles ne se sentaient pas à l'aise d'échanger ou de acheter des services sexuels contre de l'argent.
Perceptions dans la société japonaise
Normalement, il est perçu comme une extension de l'attention croissante du Japon sur le matérialisme, de nombreux critiques disent que la cause la plus importante est Enjo-kōsai. Les critiques craignent que les filles impliquées dans Enjo-kōsai deviennent des épouses et des mères inappropriées. Cette perception découle du soupçon que lorsque ces filles deviendront adultes, elles abandonneront rapidement leur loyauté et leurs engagements envers leur famille afin d'offrir de l'argent et des avantages matériels.
Cependant, certaines filles pensent que le contrôle de leur corps et des moyens de subvenir à leurs besoins est une forme d'indépendance. Les bonnes femmes au Japon sont censées être sensées, modestes, attentionnées et respectueuses, et il est clair que ces filles jettent toutes ces vertus lorsqu'elles participent à Enjo-kōsai.
Tôt ou tard, ces filles et ces jeunes femmes auraient un désir d'indépendance financière, faisant d'Enjo-kōsai un nouveau choix de marché et de formation.
Enjo-kōsai à travers les médias
Au Japon, les médias ont tendance à montrer Enjo-kōsai d'une manière très négative. Dans certaines séries, romans, entre autres, enkō a un scénario typique qui implique une fille désespérée pour de l'argent, alors elle décide de participer à Enjo-kōsai, et ce n'est que plus tard qu'elle s'arrête lorsqu'un ami ou d'autres personnes interviennent et l'informent. risques potentiels et conséquences de leur comportement.
Les médias peuvent caractériser Enjo-kōsai comme une forme de prostitution, mais cela dépend de l'angle sous lequel la situation est vue, que ce soit de la personne ou de l'accord signé avec le client, la manière la plus correcte étant de dire que le terme Enjo-kōsai caractérise l'acte de satisfaire le client de manière sexuelle, affective ou de tenir compagnie dans certains endroits, tels que les restaurants et les cafés.
L'article est toujours à moitié, mais nous recommandons déjà de lire aussi:
Législation
La prostitution est illégale au Japon depuis les années 1950, bien que la définition de la prostitution soit stricte, ne couvrant pas seulement les contacts entre les organes génitaux. Des lois spéciales sur la prostitution des enfants ont été introduites dans les années 1990. Enjo-kōsai n'était pas réglementé par le gouvernement japonais, car il ne relève pas de la définition légale de la prostitution, à moins que le client ne paie explicitement la fille pour des relations sexuelles (ce qui est rare, en raison de la nature indirecte des transactions). Étant donné que l'âge du consentement au Japon varie entre 13 et 17 ans, selon la juridiction, les clients ne peuvent pas être accusés de maltraitance d'enfants.